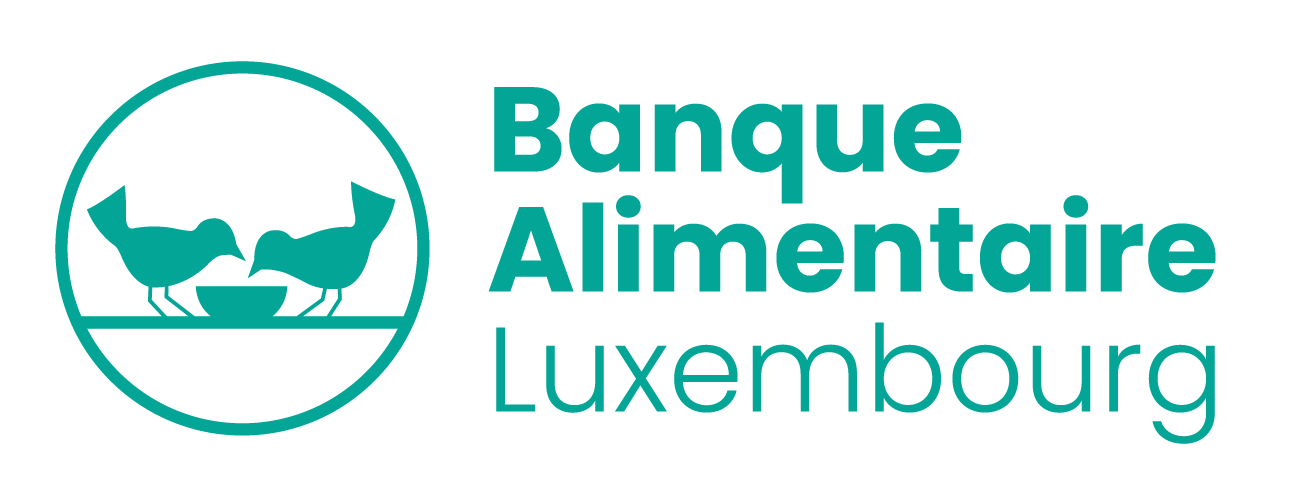DOCUMENT D’APPLICATION
DE LA CHARTE EUROPEENNNE
DES BANQUES ALIMENTAIRES
v 15 mai 2012
Introduction
La charte des Banques Alimentaires a été rédigée en 1984 par nos fondateurs. Depuis, de nombreux changements sont intervenus : le nombre de pays et de B.A s’est fortement accru, nos sociétés sont davantage sensibilisées au lien entre lutte contre la faim et lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, ainsi qu’à la lutte contre le gaspillage. Des nouvelles formes de solidarités sont apparues, les demandes des associations partenaires se sont diversifiées.
A l’issue d’une période de réflexions partagées, incluant une enquête auprès des pays membres du réseau, le Conseil d’Administration de la FEBA a décidé de garder comme référentiel d’action notre Charte historique, notre bien commun, mais de confronter nos pratiques à l’évolution de notre environnement. Ceci dans un esprit de fidélité à la Charte et avec le souci de préserver la cohésion de notre fédération européenne.
Le présent document apporte un éclairage sur des points importants de la Charte, tout en utilisant les résultats du travail collectif effectué en 2009 sur notre vision, notre mission, nos valeurs et ce qui caractérise les B.A. ll traite aussi des questions posées par la mise en œuvre de pratiques nouvelles. Appelé « document d’application de la Charte », il est appelé à évoluer avec le temps.
1. Explicitation de termes de la Charte, commentaires adaptés au temps présent
Notre mission
Les B.A sont au service des associations qui, au contact direct des personnes démunies, luttent contre la pauvreté, en particulier alimentaire, et contre l’exclusion sociale.
Cette mission constitue une spécificité des B.A, selon le modèle né aux Etats-Unis en 1964 et en développement dans le monde entier. Elle est conforme au principe de subsidiarité.
Cependant des exceptions, guidées par le souci de faire parvenir l’aide alimentaire aux personnes démunies, paraissent justifiées en cas d’urgence (par exemple pour pallier la fermeture de plusieurs associations en été), ou parce qu’il y a défaillance d’associations dans un pays ou une région ou quand des contraintes administratives (notamment sanitaires) rendent le recours aux associations impossible.
L’aide alimentaire est fournie gratuitement aux associations partenaires mais la Charte précise que les associations peuvent être appelées à participer, financièrement ou non, au fonctionnement des BA (une association peut fournir un service)
Les pays sont laissés libres du choix de la solution, en s’efforçant de prendre en compte les possibilités financières des associations et de trouver d’autres sources de financement.
En complément de l’aide alimentaire stricto sensu, les B.A s’efforcent de proposer divers services liés plus ou moins directement à cette aide et favorisant l’inclusion sociale : par exemple en accueillant et même en employant elles-mêmes des personnes en phase d’insertion ou en proposant aux associations des formations, des aides pour l’obtention d’équipements, des animations de réseaux. C’est ainsi qu’elles sont acteurs de la lutte contre l’exclusion sociale.
Don et Partage
Le fonctionnement des B.A est fondé sur le don et le partage. Ces deux notions sont liées.
Elles concernent les dons de produits alimentaires qui sont sollicités par différents circuits et ensuite partagés équitablement et sans discrimination entre associations.
En outre, des dons d’équipements (par exemple des bacs frigorifiques) peuvent être sollicités au profit des associations.
Elles concernent aussi les dons de temps et de compétences, qui peuvent venir de l’extérieur (entreprises, clubs-services, particuliers..) ou mis à disposition par les membres de la B.A. Ces dons sont partagés à l’intérieur de chaque B.A et aussi avec les associations partenaires.
Ces principes s’appliquent également au sein du réseau des B.A. Quelques pays ont commencé à organiser des solidarités entre leurs B.A sous forme de dons ou d’échanges de produits, de mutualisation de fonctions (par exemple la prospection), de missions d’audit et de conseils, d’échanges d’expériences.
Au niveau européen, en complément de ses actions d’animation du réseau, la FEBA s’efforce de consacrer depuis plusieurs années une partie de son budget à la création de B.A dans les nouveaux pays. Elle fait aussi appel à la solidarité des différents pays européens sous forme de dons d’argent et de parrainages. La solidarité européenne devient un nouveau principe d’action.
Nos deux
leviers d’action
La lutte contre le gaspillage a été à l’origine voulue et reconnue comme une spécificité des B.A à l’époque où on parlait peu de développement durable. A ce titre, les B.A ont demandé (avec d’autres organisations humanitaires) que les stocks de l’Union Européenne ne soient pas détruits mais distribués aux personnes démunies. Elles sollicitent également les agriculteurs, les entreprises de l’agroalimentaire et les chaines de distribution, mais encore peu les cantines (entreprises, écoles, hôpitaux).
Elles participent aussi à la sensibilisation des associations et des jeunes.
Elles sont parfois à l’origine ou partenaires d’études sur l’impact écologique du gaspillage. Ainsi elles sont de fait des acteurs de la protection de l’environnement et même du développement durable
L’appel à la solidarité est effectué de deux manières, en pleine conformité avec les valeurs de don et de partage.
Pour leurs approvisionnements, les B.A sollicitent l’Union Européenne en plaidant pour la pérennité des achats de produits en complément ou en substitution des stocks. Elles sollicitent également la filière agro-alimentaire pour des dons de produits ainsi que le grand public lors des collectes qui sont organisées avec le concours de centaines de milliers de bénévoles. Ainsi elles sont créatrices de cohésion sociale.
En acceptant d’être dépendantes des autres pour leur fonctionnement : dépendantes d’approvisionnements gratuits de denrées, dépendantes d’associations qui incluent l’aide alimentaire dans leur démarche d’accompagnement des personnes démunies, dépendantes financièrement.
Par cette formule, les fondateurs ont exprimé que la primauté n’est pas dans la recherche de fonds, mais plutôt dans la promotion de la solidarité au sein du corps social.
Par ailleurs, donner le témoignage de la pauvreté ne se résume pas dans le seul fait d’interpeller la société sur la persistance de la pauvreté. Les B.A doivent s’efforcer de fonctionner avec une certaine économie de moyens, avec un train de vie modeste.
2. Réponses aux questions posées quant à l’évolution des pratiques des B.A.
Distribuer
des produits
d’hygiène
et d’entretien ?
Les BA sont spécialisées dans l’aide alimentaire. En distribuant des produits d’hygiène et d’entretien, elles sortent en partie de leur vocation initiale car, si elles luttent toujours contre la pauvreté, elles ne luttent pas directement contre la faim. Cependant elles répondent aux besoins exprimés par les associations partenaires.
Les B.A. peuvent accepter et distribuer des produits d’hygiène et d’entretien.
Accepter
des dons
d’argent afin
d’acheter
des produits
alimentaires ?
Certaines personnes et entreprises préfèrent effectuer des dons dédiés, plutôt que d’acheter elles-mêmes des produits alimentaires. Solliciter de l’argent est une solution qui peut freiner les efforts de prospection de produits, de lutte contre le gaspillage et d’appel à la solidarité. On risque de casser la dynamique de la B.A en privilégiant l’option à court terme d’acheter des produits par rapport à l’investissement dans le fonctionnement à long terme. Acheter des produits, même à très bas prix, peut aussi inciter le donateur à vendre aux B.A plutôt qu’à donner.
Les B.A ne recherchent pas de dons d’argent dédiés à l’achat de produits alimentaires mais peuvent accepter exceptionnellement de tels dons.
Rechercher des fonds auprès du grand public
afin de couvrir les besoins de fonctionnement ou d’investissement ?
La charte reconnaît que le fonctionnement des B.A est assuré par des dons de personnes ou d’organismes privés et par des subventions publiques. La question ne porte donc que sur l’appel au grand public, pratique peu répandue encore actuellement dans les B.A afin de concentrer les appels sur les collectes de denrées et ne pas brouiller l’image des B.A.
La recherche de fonds pour le fonctionnement doit rester secondaire par rapport à la recherche de produits alimentaires. Elle doit être faite dans le respect des règles d’éthique.
Quelle indépendance
par rapport
aux pouvoirs
politiques,
économiques
et religieux ?
La charte stipule que « les BA sont animées par des bénévoles et des associations d’inspirations spirituelles et humaines différentes ». Alors même que de nombreuses B.A reçoivent des subventions ou des dons, il importe qu’elles restent indépendantes des pouvoirs politiques, économiques et religieux. Ainsi, leurs instances dirigeantes doivent être composées en majorité de membres représentant directement les intérêts des B.A.
Une autre marque de cette indépendance réside dans la non-discrimination des associations partenaires.
Quelle place
pour bénévoles
et salariés
dans la direction
et l’animation
des B.A. ?
Le modèle des BA a été fondé sur des bénévoles. Or les B.A comptent aujourd’hui en moyenne 10% de salariés (dont ¼ sont en contrat de réinsertion sociale). Si le bénévolat constitue la force vive de nos réseaux, l’accomplissement de la mission nécessite une permanence dans la fonction que le bénévolat ne permet pas toujours de réaliser. Il est aussi parfois difficile de trouver des bénévoles ayant des compétences spécifiques.
Par ailleurs, dans les pays à bas revenus, un complément de salaire ou de retraite est nécessaire pour beaucoup de personnes et dans certains pays, la priorité est donnée à l’emploi et à l’insertion sociale plutôt qu’au bénévolat.
Les BA peuvent faire appel à des salariés pour que la permanence de certaines fonctions soit assurée ou pour pouvoir disposer de compétences spécifiques. Mais puisque les BA sont des associations à but non lucratif, leurs organes de gouvernance doivent être constitués en grande majorité de bénévoles.
© Reproduction autorisée moyennant indication de la source